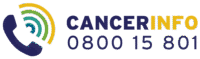Menu

En savoir plus sur les principaux examens diagnostiques du cancer. Découvrez les méthodes utilisées pour détecter et diagnostiquer le cancer.
La radiographie est une technique classique d’imagerie médicale qui utilise des rayons X. Il est possible de radiographier toutes les parties du corps. Pour obtenir des images plus détaillées, un CT-scan ou une IRM peuvent être nécessaires.
Un Scanner ou CT-scan (CT pour Computer Tomography, tomodensitométrie) fournit des images très détaillées des organes, avec une précision de l’ordre du millimètre. L’appareil se présente comme un énorme anneau, dans l’ouverture duquel glisse le patient, allongé sur une table mobile. À chaque déplacement de la table vers l’intérieur de l’appareil, une série de clichés est prise.
Un CT-scan peut être réalisé avec ou sans produit de contraste. Dans le premier cas, le produit de contraste doit être administré avant et/ou pendant l’examen, le plus souvent via perfusion.
L’échographie utilise des ondes sonores. L’écho (réflexion) des ondes permet de visualiser les organes sur un écran.
Pour le patient, une échographie est un examen simple et indolore. L’échographie n’utilise pas de rayons X et est donc sans danger.
L’échographie permet d’obtenir des images de différents organes ou structures. Le médecin utilisera par exemple cette technique pour rechercher l’image d’éventuelles métastases dans le foie, les reins ou les ganglions lymphatiques.
Une IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) permet, d’obtenir des images de l’intérieur du corps à l’aide de champs magnétiques. L’IRM permet de visualiser des « coupes » virtuelles du corps en montrant les différents organes présents à l’endroit de la “coupe”.
Une IRM peut prendre quelques dizaines de minutes et peut parfois être désagréable pour le patient qui est obligé de rester allongé immobile sur le dos dans une sorte de tunnel. En outre, l’appareil IRM est bruyant. Cet examen est parfois nécessaire pour compléter ou remplacer les autres techniques d’imagerie médicale.
En raison de l’utilisation de puissants champs magnétiques, l’IRM est contre-indiquée chez les personnes porteuses d’un stimulateur cardiaque ou d’une prothèse auditive interne.
Le PET-scan ou Tomographie par Émission de Positrons est utilisé pour étudier l’activité métabolique des tissus. Les cellules cancéreuses se caractérisent par un métabolisme accéléré et consomment énormément d’énergie. C’est cette activité que le PET-scan met en évidence.
Pour cet examen, un produit faiblement radioactif (isotope) est injecté dans l’organisme. Il se fixe sur les cellules de la tumeur et/ou sur ses métastases. Cette étape peut prendre une à deux heures. Le patient est ensuite allongé sur la table d’examen du PET-scan (qui ressemble à un scanner) et passe lentement au travers l’anneau de l’appareil. Les capteurs de la machine enregistrent l’activité radioactive du produit injecté. Une fois l’examen fini, de puissants ordinateurs reconstituent les images finales à partir des données enregistrées.
Un PET-scan peut être combiné à un CT-scan pour donner une image précise du métabolisme et de l’anatomie. Les médecins localisent avec grande précision les tumeurs et les métastases.
L’isotope est éliminé par l’organisme en quelques heures et ne provoque pas d’effets secondaires connus à long terme. Le PET-scan est formellement contre-indiqué en cas de grossesse ou d’allaitement.
La biopsie est le prélèvement chirurgical d’un fragment de tissu suspect. Elle se fait sous anesthésie locale ou générale.
Ce prélèvement est ensuite envoyé en laboratoire pour être examiné au microscope. Il permet de poser avec certitude le diagnostic de cancer.
La prise de sang fournit des informations générales sur l’état de santé mais donne peu d’indications sur la nature et le degré d’évolution d’un cancer.
Lorsqu’une tumeur cancéreuse est diagnostiquée, le médecin demandera dans certains cas un dosage sanguin des biomarqueurs. Un biomarqueur est une caractéristique biologique mesurable avec précision. Il est utilisé pour mesurer une fonction du corps, une maladie ou l’action d’un médicament. Au fil des ans, des biomarqueurs ont été découverts pour un grand nombre de cancers.
Dans certains cas, le médecin contrôlera régulièrement ces biomarqueurs afin d’évaluer l’efficacité du traitement. Ces contrôles seront poursuivis après la fin des traitements pour repérer les signes d’une récidive éventuelle.

Des professionnels pour répondre à toutes vos questions sur le cancer