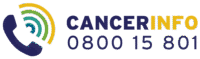Menu

Comprendre les différentes options de traitement d’un cancer et découvrez les avancées médicales dans le domaine du cancer.
La chirurgie oncologique signifie que la tumeur est retirée par une opération chirurgicale.
Dans la plupart des cas, le chirurgien retire la ou les tumeur(s) ainsi qu’une partie des tissus qui l’entourent. Ceci pour éviter que des cellules cancéreuses ne restent en place et éviter une récidive locale de la tumeur. Le chirurgien peut également retirer les ganglions lymphatiques proches du lieu de la tumeur. Ces ganglions sont un premier relais de dissémination possible de la tumeur. Savoir s’ils sont ou non atteints par les cellules cancéreuses est une information importante pour déterminer la suite du traitement.
La chirurgie est recommandée pour la plupart des cancers dits ‘solides’.
Le traitement chirurgical peut avoir des effets secondaires liés à l’opération ou aux médicaments utilisés. Le temps de récupération varie d’une personne à l’autre et dépend du type de chirurgie. Il est normal de se sentir fatigué ou faible pendant un certain temps. En règle générale, une chirurgie plus complexe comporte un risque plus élevé d’effets secondaires.
Les effets secondaires courants de la chirurgie oncologique sont :
C’est pourquoi il est important que la personne en traitement en parle avec son médecin avant le début de son traitement pour savoir à quels symptômes elle doit prêter attention.
N’hésitez jamais à interroger l’équipe soignante (médecins, infirmières et autres) et à répéter vos questions si nécessaire, jusqu’à obtenir une réponse compréhensible. Construisez un véritable dialogue avec vos soignants. Cela vous permettra de prendre, de commun accord et en toute confiance, les meilleures décisions possibles.
La radiothérapie utilise des rayonnements de très haute énergie pour détruire les cellules cancéreuses. La plupart des cancers peuvent être traités par radiothérapie. Cependant, elle ne sera pas utilisée si d’autres traitements s’avèrent plus efficaces ou si le type de tumeur n’est pas sensible aux radiations.
La radiothérapie endommage le matériel génétique des cellules à division rapide comme les cellules cancéreuses. Elle rend la croissance de ces cellules plus difficile et peut aussi les tuer. Malheureusement, dans la zone irradiée, la radiothérapie abîme aussi les cellules saines à division rapide, ce qui peut provoquer des effets secondaires. Cependant, les cellules saines récupèrent mieux que les cellules cancéreuses. Ceci explique pourquoi ce traitement peut détruire les cellules cancéreuses tout en préservant dans une certaine mesure les tissus sains.
La radiothérapie est recommandée pour traiter certains cancers à certains stades. Tous les malades ne sont donc pas automatiquement concernés par ce traitement. Généralement, la radiothérapie est associée à un ou plusieurs autre(s) traitement(s).
La radiothérapie peut être utilisée :
Les effets secondaires locaux dépendent de la zone irradiée et du type de radiothérapie. Des effets secondaires généraux peuvent également accompagner la radiothérapie. Les plus fréquents sont
Les effets secondaires de la radiothérapie varient considérablement d’une personne à l’autre, en fonction de la technique utilisée et de la zone du corps qui a été irradiée. Présenter ou non des effets secondaires ne signifie pas que la radiothérapie fonctionne mieux ou moins bien.
C’est pourquoi il est important que la personne en parle avec son médecin avant le début de son traitement pour savoir à quels symptômes elle doit prêter attention.
N’hésitez jamais à interroger l’équipe soignante (médecins, infirmières et autres) et à répéter vos questions si nécessaire, jusqu’à obtenir une réponse compréhensible. Construisez un véritable dialogue avec vos soignants. Cela vous permettra de prendre, de commun accord et en toute confiance, les meilleures décisions possibles.
La chimiothérapie est un traitement contre le cancer qui utilise des médicaments qui tuent les cellules cancéreuses et/ou limitent leur croissance.
Les médicaments de chimiothérapie endommagent le matériel génétique des cellules à division rapide comme les cellules cancéreuses. Elle rend la croissance de ces cellules plus difficile et peut aussi les tuer. Les médicaments de chimiothérapies endommagent également les cellules saines à division rapide. Cependant, les cellules saines récupèrent mieux que les cellules cancéreuses. Ceci explique pourquoi ce traitement peut détruire les cellules cancéreuses tout en permettant aux tissus sains de récupérer.
La chimiothérapie est recommandée pour traiter certains cancers à certains stades. Tous les malades ne sont donc pas automatiquement concernés par ce traitement. Généralement, la chimiothérapie est associée à un ou plusieurs autre(s) traitement(s).
La chimiothérapie peut être administrée dans différentes situations :
Les effets secondaires généraux et principaux de la chimiothérapie sont souvent associés à l’endommagement des cellules normales à division rapide : celles du sang, des muqueuses de la bouche et du tube digestif, des ongles, de la paroi intérieure du vagin et des follicules pileux, etc.
Certains effets secondaires plus spécifiques dépendant du type de molécules de chimiothérapie utilisées.
Certaines chimiothérapies peuvent abimer plus sélectivement les nerfs, le foie, les reins ou d’autres organes.
Les principaux effets secondaires de la chimiothérapie sont :
Les effets secondaires et leur gravité dépendent d’une personne à l’autre et d’un médicament à l’autre. La présence et la gravité des effets secondaires ne sont pas liées à l’efficacité du traitement.
C’est pourquoi il est important que la personne en parle avec son médecin avant le début de son traitement pour savoir à quels symptômes elle doit prêter attention.
N’hésitez jamais à interroger l’équipe soignante (médecins, infirmières et autres) et à répéter vos questions si nécessaire, jusqu’à obtenir une réponse compréhensible. Construisez un véritable dialogue avec vos soignants. Cela vous permettra de prendre, de commun accord et en toute confiance, les meilleures décisions possibles.
L’immunothérapie est un ensemble de traitements qui utilisent le système immunitaire pour éliminer les cellules cancéreuses.
Le système immunitaire (notre système de défense interne) reconnaît et élimine ce qui est étranger à notre corps comme les bactéries ou les virus par exemple. Il reconnaît et détruit également les cellules anormales comme les cellules cancéreuses. En revanche, il ne réagit pas contre les cellules normales.
Le système immunitaire reconnaît des antigènes, des molécules provenant des agents infectieux ou des protéines anormales des cellules cancéreuses. Ces antigènes sont absents des cellules normales.
L’immunothérapie renforce le système immunitaire et l’aide à combattre les cellules cancéreuses. Elle aide le système immunitaire à “comprendre” quelles cibles attaquer sur les cellules cancéreuses ou interrompt les collaborations (néfastes pour la personne) entre cellules cancéreuses et cellules immunitaires.
Il existe de nombreuses formes d’immunothérapie, et les chercheurs continuent à trouver de nouveaux modes d’action.
L’immunothérapie est envisagée au cas par cas par l’équipe soignante en fonction de toute une série de critères médicaux (type particulier de cancer, stade …).
Actuellement, l’immunothérapie peut faire partie du traitement standard d’une série de cancers, notamment (et de manière non exhaustive, cette liste évoluant constamment) le mélanome, le cancer du sein, le cancer du rein, le cancer de la vessie, certains cancers de la tête et du cou, le lymphome hodgkinien et certaines formes de leucémies…
Par ailleurs des études cliniques se poursuivent pour voir dans quelle mesure une forme d’immunothérapie pourrait être utile face à d’autres cancers.
Comme tous les traitements contre le cancer, l’immunothérapie présente à la fois des avantages, des risques et des effets secondaires.
Ces effets secondaires sont très différents de ceux d’une chimiothérapie classique (nausées, chute des cheveux ou de poils… ) et varient d’un type d’immunothérapie à l’autre et d’un patient à l’autre.
Les traitements stimulant le système immunitaire et les réactions inflammatoires peuvent causer des symptômes pseudo-grippaux (fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, fatigue …) et induire des réactions auto-immunitaires (le système immunitaire attaquant des cellules normales).
C’est pourquoi il est important que la personne en parle avec son médecin avant le début de son traitement pour savoir à quels symptômes elle doit prêter attention.
N’hésitez jamais à interroger l’équipe soignante (médecins, infirmières et autres) et à répéter vos questions si nécessaire, jusqu’à obtenir une réponse compréhensible. Construisez un véritable dialogue avec vos soignants. Cela vous permettra de prendre, de commun accord et en toute confiance, les meilleures décisions possibles.
Les thérapies ciblées sont un ensemble de traitements conçus pour bloquer la croissance ou la dissémination des cellules cancéreuses. Ces traitements interfèrent avec des modifications moléculaires ou avec des mécanismes qui sont à l’origine du développement et/ou de la dissémination de ces cellules tumorales.
Il existe plusieurs types de thérapies ciblées, qui fonctionnent toutes différemment.
Les thérapies sont regroupées en deux catégories principales : en fonction de l’effet de la substance active et en fonction de sa taille.
Lorsque le médicament ciblé s’est fixé à sa cible, plusieurs effets peuvent être provoqués :
La plupart des thérapies ciblées ne sont efficaces que contre un cancer présentant des caractéristiques très spécifiques. Elles ne peuvent donc pas être utilisées pour tous les types de cancer ni chez tous les malades.
Une thérapie ciblée vient généralement compléter des traitements classiques (chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie). Elle peut aussi être administrée comme seule thérapie (monothérapie).
Actuellement, les thérapies ciblées peuvent faire partie du traitement standard d’une série de cancers, notamment (et de manière non exhaustive, cette liste évoluant constamment) : cancer de l’estomac, cancer de la vessie, tumeurs cérébrales, cancer du sein, cancer du col de l’utérus, cancer du côlon, cancers de la tête et du cou, cancers du rein, leucémie, cancer du foie, cancer du poumon, lymphomes, myélome multiple, cancer de l’ovaire, cancer du pancréas, cancer de la prostate, cancer de la peau, cancer de la thyroïde…
En général, les thérapies ciblées provoquent moins d’effets secondaires que la chimiothérapie parce qu’elles “sélectionnent” leurs cellules cibles d’une autre manière.
Les principaux effets secondaires des thérapies ciblées (liste alphabétique et non exhaustive) :
C’est pourquoi il est important que la personne en parle avec son médecin avant le début de son traitement pour savoir à quels symptômes elle doit prêter attention.
N’hésitez jamais à interroger l’équipe soignante (médecins, infirmières et autres) et à répéter vos questions si nécessaire, jusqu’à obtenir une réponse compréhensible. Construisez un véritable dialogue avec vos soignants. Cela vous permettra de prendre, de commun accord et en toute confiance, les meilleures décisions possibles.
La radiothéranostique est une forme innovante de traitements ciblés de certains cancers. Radiothéranostique est une contraction de thérapie et diagnostic. Elle combine deux choses au même moment :
La radiothéranostique utilise des molécules capables de reconnaître les cellules cancéreuses et de s’y attacher. Ces molécules – appelées ligands – sont attachées à une petite source de radioactivité. Ces radioligands peuvent être injectés dans le sang ou pris par voie orale.
Une fois dans le corps, ils sont transportés par le sang et vont se fixer sur les cellules cancéreuses. Un scanner permet tout d’abord d’identifier les organes et les régions du corps où un cancer ou des métastases se développent. C’est la partie diagnostic.
Au même moment la particule radioactive détruit les cellules cancéreuses sur lesquelles elle est fixée. C’est la partie thérapie. Le reste du corps est presque épargné.
Après le traitement, la même technique est utilisée pour évaluer les résultats.
La radiothéranostique est surtout utilisée quand les autres traitements ne fonctionnent plus très bien. Par exemple, pour certains cancers de la prostate métastasés ou des tumeurs neuroendocrines.
Elle vise non seulement à stopper, mais aussi à inverser la progression (des métastases) de la maladie, tout en offrant aux patients une qualité de vie la meilleure possible.
De nombreux recherches sont en cours pour d’autres types de cancers.
Grâce à son ciblage précis, la radiothéranostique à moins d’effets secondaires par rapport aux traitements anticancéreux classiques.
Les effets secondaires qui pourraient apparaitre sont :
Il est important que la personne en parle avec son médecin avant le début de son traitement pour savoir à quels symptômes elle doit prêter attention.
L’hormonothérapie est un traitement qui consiste à bloquer l’action ou la production d’hormones naturelles afin d’empêcher le développement des cellules cancéreuses. L’hormonothérapie vise à entraîner la mort des cellules cancéreuses à plus long terme en créant un milieu hormonal qui leur est défavorable (contrairement à la chimiothérapie ou à la radiothérapie, qui cherchent à tuer rapidement les cellules cancéreuses).
Le développement de certaines cellules cancéreuses est stimulé par des hormones qui se fixent sur des récepteurs à la surface de ces cellules. Ces récepteurs sont alors activés, déclenchant des réactions à l’intérieur de la cellule, comme par exemple une division cellulaire. On peut comparer l’hormone à une clef qui permet d’ouvrir une serrure (le récepteur hormonal). Cela permet de comprendre les stratégies qui ont été développées au niveau des traitements d’hormonothérapie :
L’hormonothérapie n’est utile que face à un cancer hormonosensible, c’est-à-dire un cancer dont la croissance est stimulée par les hormones.
Pour savoir si on a affaire à un cancer hormonosensible, une analyse en laboratoire est nécessaire car toutes les cellules cancéreuses ne sont pas nécessairement porteuses de récepteurs hormonaux. Cette analyse exige le prélèvement d’un morceau de tumeur.
Si nécessaire, une hormonothérapie peut être proposée, seule ou en combinaison avec d’autres traitements. L’hormonothérapie a pris une importance particulière dans le traitement de certains cancers du sein et de la prostate. Parfois elle est également utilisée face à d’autres tumeurs malignes (utérus, thyroïde, ovaire, rein).
Comme tous les traitements contre le cancer, l’hormonothérapie présente à la fois des avantages, des risques et des effets secondaires.
De nombreux effets secondaires dépendent du type de traitement ou de médicament administrés et varient d’une personne à l’autre.
Les principaux effets secondaires de l’hormonothérapie sont
C’est pourquoi il est important que la personne en parle avec son médecin avant le début de son traitement pour savoir à quels symptômes elle doit prêter attention.
N’hésitez jamais à interroger l’équipe soignante (médecins, infirmières et autres) et à répéter vos questions si nécessaire, jusqu’à obtenir une réponse compréhensible. Construisez un véritable dialogue avec vos soignants. Cela vous permettra de prendre, de commun accord et en toute confiance, les meilleures décisions possibles.
La greffe de cellules souches consiste à injecter au patient des cellules souches (cellules non spécialisées) qui se développeront en cellules spécialisées saines et remplaceront les tissus endommagés. La greffe de cellules souches hématopoïétiques vise à remplacer les cellules souches qui produisent les cellules sanguines lorsque la moelle osseuse est endommagée ou détruite en raison d’une maladie (comme le cancer), de la prise de médicaments ou d’une irradiation.
Avant de procéder à la greffe proprement dite, on détruit la moelle osseuse malade à l’aide d’une chimiothérapie à haute dose et/ou par une irradiation du corps entier. C’est ce que l’on appelle le conditionnement pré-greffe. L’objectif est de détruire un maximum de cellules cancéreuses avant la greffe.
En détruisant la moelle osseuse, le patient est extrêmement vulnérable aux infections. Il doit être placé dans une “bulle” stérile jusqu’à ce que la greffe de cellules souches hématopoïétiques ait “pris”.
Il existe trois types de greffes hématopoïétiques :
La greffe de cellules souches hématopoïétiques est une intervention complexe qui présente des risques. Elle a lieu exclusivement dans des hôpitaux spécialisés, et est mené par des équipes de professionnels de la santé hautement qualifiés.
En cas de risque élevé de récidive, ou lorsqu’une rechute se produit, certaines personnes atteintes d’un cancer hématologique se voient proposer une greffe de cellules souches hématopoïétiques.
Les principales indications pour l’autogreffe sont :
Les principales indications pour l’allogreffe sont :
Comme tous les traitements contre le cancer, la greffe de cellules souches présente à la fois des avantages, des risques et des effets secondaires.
L’effet secondaire le plus important sont les infections. Elles sont dues aux faibles niveaux de globules blancs dans le corps
Effets secondaires pouvant apparaître juste après les fortes doses de chimiothérapie utilisées avant la greffe :
Effets secondaires à long terme (des mois ou des années plus tard) des greffes :
Un autre effet secondaire de l’allogreffe est :
C’est pourquoi il est important que la personne en parle avec son médecin avant le début de son traitement pour savoir à quels symptômes elle doit prêter attention.
N’hésitez jamais à interroger l’équipe soignante (médecins, infirmières et autres) et à répéter vos questions si nécessaire, jusqu’à obtenir une réponse compréhensible. Construisez un véritable dialogue avec vos soignants. Cela vous permettra de prendre, de commun accord et en toute confiance, les meilleures décisions possibles.
Une étude clinique est menée en accord avec des patients pour évaluer une nouvelle technique médicale ou un nouveau traitement. Ce dernier a d’abord été mis au point en laboratoire, puis testé sur des animaux. Si les résultats préliminaires sont concluants, le nouveau traitement peut être proposé à un certain nombre de patients afin d’en vérifier l’efficacité et la toxicité, mais également sa supériorité éventuelle par rapport au traitement de référence.
Seules les personnes qui le désirent participent à une étude clinique.
Tous les malades ne sont pas concernés. Des conditions médicales très strictes doivent être réunies pour pouvoir participer à ce type d’étude. C’est ce que l’on appelle les critères d’inclusion. Ces critères sont liés au type de cancer, à l’âge du patient, à son état général, au stade de la maladie, aux traitements préalablement reçus, etc.
Ces critères sont indispensables pour pouvoir interpréter correctement les résultats de l’étude clinique.
Pour savoir si vous pourriez éventuellement participer à une étude clinique, posez la question à votre oncologue.
Parmi les motivations on trouve :
Une étude clinique, comme n’importe quel traitement, s’accompagne de certains risques. Dans le cas des études cliniques, ces risques ne sont pas encore tous connus à l’avance. Toutes les études cliniques sont soumises à l’approbation d’un comité d’éthique qui veille au respect d’obligations règlementaires nationales et internationales très strictes, notamment pour garantir la meilleure sécurité possible aux patients.
Même si des recherches approfondies ont été effectuées au préalable, avant de passer à l’expérimentation chez l’Homme, il subsiste une zone d’incertitude et de risque. C’est pourquoi les patients sont surveillés attentivement pendant et après le traitement. C’est à la fois un avantage (suivi médical renforcé) et une contrainte (visites plus fréquentes, examens additionnels, etc.).
Avant d’accepter de participer ou non à une étude clinique, chaque personne doit tout d’abord être informée et ensuite prendre le temps de la réflexion. Si elle est d’accord, elle signe un document de “consentement éclairé” qui garantit qu’elle a bien été informée sur l’étude, son déroulement, ses risques et ses contraintes. Le suivi biologique, médical et clinique dont elle bénéficiera durant toute l’étude clinique lui assurera la plus grande sécurité possible. Aucun surcoût médical, généré par l’étude, ne sera à charge du patient. Chaque malade ayant donné son accord reste libre à tout moment de retirer son consentement et de quitter l’étude. Il continuera alors à être soigné suivant les traitements de référence qui s’appliquent à sa situation particulière.
Les médecins qui effectuent une étude clinique suivent un plan thérapeutique particulier appelé “protocole”. Il est très important pour les patients participant à une étude clinique de comprendre le protocole mais aussi son but. Les médecins référents sont là pour répondre aux questions.
Généralement, dans une étude clinique, les participants sont répartis au hasard en deux groupes :
Ni le patient, ni le médecin ne savent qui reçoit le traitement standard ou le traitement expérimental. Ceci afin d’éviter toute influence ou préjugé qui risquerait de fausser les résultats. La répartition des patients dans chacun des deux groupes se fait de façon aléatoire par tirage au sort (randomisation en double aveugle). C’est seulement lors de l’analyse des résultats que l’on sait qui a reçu quel traitement.
Le meilleur interlocuteur est et doit rester l’oncologue. Il connait en détail le dossier médical et a accès à de nombreuses banques de données nationales ou internationales. Ces banques de données référencent les études cliniques en cours, en précisant les conditions médicales pour pouvoir y participer. C’est donc l’oncologue qui pourra orienter le patient en toute connaissance de cause vers une éventuelle étude clinique, en Belgique ou le cas échéant à l’étranger.

Des professionnels pour répondre à toutes vos questions sur le cancer