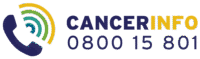Menu

Découvrez l’importance des examens de diagnostic du cancer de la prostate pour détecter et traiter cette maladie.
En cas de symptômes suspects, le médecin (médecin traitant ou urologue) palpe la prostate via le rectum (partie de l’intestin juste derrière l’anus). Il évalue si la prostate est anormalement dure, si elle est plus grosse que la normale ou si elle présente des nodules (petites bosses).
L’urologue (ou le radiologue) introduit une sonde échographique via le rectum (partie de l’intestin juste en amont de l’anus). Il obtient ainsi une image de la glande qui lui permet d’évaluer son volume et sa texture.
Si l’urologue repère une zone suspecte à l’échographie, il procède à une biopsie. Celle-ci se fait sous échographie via le rectum (en amont de l’anus). L’urologue introduit une fine aiguille dans la prostate et prélève quelques cellules dans la zone suspecte. Ces cellules sont ensuite analysées au microscope dans un laboratoire spécialisé. C’est la seule analyse qui permet d’établir un diagnostic avec certitude. Elle donne également des informations importantes sur le degré d’agressivité des cellules cancéreuses.
Une IRM de la prostate se déroule soit comme une IRM classique, soit en utilisant une sonde endorectale (par le rectum).
Un taux élevé de PSA (marqueur prostatique) dans le sang peut être associé à un cancer de la prostate. Ce n’est cependant pas toujours le cas. Une hausse du PSA peut avoir d’autres explications que le cancer (augmentation du volume, normale avec l’âge, toucher rectal, …). Par ailleurs, certains cancers de la prostate ne provoquent pas d’augmentation du PSA. Il s’agit donc d’un élément à interpréter en fonction du résultat des autres examens de diagnostic.
Les autres examens possibles sont :

Des professionnels pour répondre à toutes vos questions sur le cancer