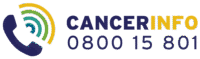Menu

Découvrez les différents traitements du cancer de la prostate pour une prise en charge optimale de cette maladie.
L’opération chirurgicale consiste à enlever complètement la prostate et les vésicules séminales. Elle peut être complétée par l’enlèvement des ganglions lymphatiques proches. (Ceux-ci seront analysés pour vérifier que la maladie ne s’y est pas étendue.) L’opération peut être effectuée de manière classique ou par laparoscopie (assistée ou non par un robot).
La chirurgie est généralement proposée aux hommes relativement jeunes et en bonne santé.
La radiothérapie est utilisée pour détruire les cellules cancéreuses à l’aide de rayons X de haute énergie. Elle peut être proposée seule ou après la chirurgie pour limiter le risque de récidive. Différents schémas d’irradiation (nombre de séances) sont envisageables.
Cette technique consiste à implanter définitivement des grains radioactifs directement dans la prostate. Chaque grain est composé d’une source radioactive encapsulée dans du titane. La mise en place se fait sous anesthésie générale, au moyen d’aiguilles.
L’irradiation délivrée n’agit qu’au contact immédiat des grains et ne présente pas de risque pour l’entourage. Par mesure de prudence, des contacts rapprochés avec de très jeunes enfants (comme les tenir sur les genoux) ou les femmes enceintes seront temporairement évités.
Cette forme de radiothérapie est utilisable chez des patients fragiles pour qui une chirurgie classique serait contre-indiquée et en cas de tumeurs peu agressives.
Cette méthode vise à tuer les cellules cancéreuses par choc thermique. Elle consiste à concentrer les ultrasons sur une petite partie de la prostate dans laquelle la température atteint 80°C.
Il s’agit d’une technique peu agressive, qui nécessite une hospitalisation de courte durée et engendre des effets secondaires limités. Elle est encore considérée comme expérimentale et utilisée dans le cadre de recherches cliniques.
Une sonde est introduite dans la prostate pour détruire les tissus par congélation.
La cryothérapie est peu utilisée comme traitement initial. Elle est plutôt considérée comme une thérapie expérimentale en cours de développement.
L’hormonothérapie a pour but de bloquer ou de ralentir fortement le développement des cellules cancéreuses. Elle crée un milieu hormonal qui leur est défavorable. Le but du traitement est de réduire très fortement la production de testostérone (castration chirurgicale ou médicamenteuse) et / ou d’empêcher la testostérone d’agir au niveau des cellules cancéreuses (traitement médicamenteux).
Il existe plusieurs méthodes d’hormonothérapie pour le cancer de la prostate :
Pour le cancer de la prostate, l’hormonothérapie peut être utilisé comme traitement adjuvant, en plus de la chirurgie ou de la radiothérapie. Au stade palliatif, elle devient un traitement de référence lorsque le cancer est sensible aux hormones.
Lorsqu’un cancer de la prostate est à un stade avancé, un traitement par chimiothérapie peut être proposé pour ralentir l’évolution de la maladie et soulager les symptômes.
N’hésitez jamais à interroger l’équipe soignante (médecins, infirmières et autres soignants) et à répéter vos questions si nécessaire, jusqu’à obtenir une réponse compréhensible. Construisez un véritable dialogue avec vos soignants. Cela vous permettra de prendre, de commun accord et en toute confiance, les meilleures décisions possibles.

Des professionnels pour répondre à toutes vos questions sur le cancer