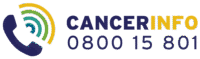Menu

Découvrez les différents traitements du cancer de la vessie et les options disponibles pour combattre la maladie.
Le type de chirurgie dépend de la taille et de l’emplacement de la tumeur.
Pour la majorité des tumeurs superficielles, une ablation chirurgicale limitée peut être pratiquée par endoscopie via les voies naturelles.
Chez certains patients, il faudra recourir à une ablation totale de la vessie (cystectomie).
La chirurgie sera complétée dans certains cas par d’autres traitements (lavages vésicaux, chimiothérapie, radiothérapie, …) pour réduire le risque de récidive.
Le lavage de la vessie par des médicaments peut être administré après une opération par voie naturelle (traitement adjuvant). Le traitement s’étale généralement sur une période de 6 mois à 3 ans.
Les médicaments injectés sont soit :
Les patients présentant une ou plusieurs tumeurs à croissance superficielle dans la vessie peuvent parfois bénéficier d’un traitement au laser, par cystoscopie (via les voies naturelles).
La chimiothérapie utilise des médicaments qui tuent les cellules cancéreuses et/ou limite leur croissance. Elle est presque toujours proposée dans les traitements de cancers de la vessie de stade 2 ou 3. On l’administre souvent avant une cystectomie totale (ablation de la vessie). Elle peut aussi être indiquée comme traitement unique ou après la chirurgie.
Une radiothérapie externe peut être proposée comme traitement du cancer de la vessie. Elle intervient le plus souvent lors d’un cancer métastatique si la chirurgie n’est pas possible, ou pour maîtriser un saignement ou une douleur.
Il s’agit d’un traitement qui utilise le système immunitaire du patient pour éliminer les cellules cancéreuses. L’immunothérapie de dernière génération peut être proposée sur un cancer métastatique qui continue de se développer malgré une chimiothérapie (cisplatine) ou qui récidive.
Ces médicaments s’attaquent aux cellules cancéreuses en perturbant sélectivement certaines étapes-clés de leur fonctionnement. Ces thérapies ne sont pas efficaces pour toutes les tumeurs. Avant de les administrer, le médecin doit déterminer si les cellules de la tumeur pourront être ciblées par un médicament particulier. C’est ce qu’on appelle “le profilage tumoral”. Dans le cas du cancer de la vessie, une mutation dans le gène FGFR sera recherchée. La thérapie ciblée traite un cancer avancé lorsque les autres traitements n’ont pas fonctionné.
N’hésitez jamais à interroger l’équipe soignante (médecins, infirmières et autres soignants) et à répéter vos questions si nécessaire, jusqu’à obtenir une réponse compréhensible. Construisez un véritable dialogue avec vos soignants. Cela vous permettra de prendre, de commun accord et en toute confiance, les meilleures décisions possibles.

Des professionnels pour répondre à toutes vos questions sur le cancer