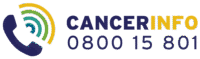Menu

Comprendre les traitements du cancer du sein et les options disponibles pour une prise en charge personnalisée.
La chirurgie est souvent la première étape du traitement d’un cancer du sein. Le chirurgien essaiera, dans la mesure du possible, de conserver le sein en procédant à une ablation limitée.
La tumorectomie consiste à enlever la tumeur et un volume limité des tissus sains qui l’entourent, en tenant compte d’une marge de sécurité suffisante. On l’appelle aussi chirurgie conservatrice, parce qu’elle permet de conserver une (grande) partie du sein.
Cette intervention chirurgicale, aussi appelée mammectomie, consiste à enlever l’entièreté du sein.
Le curage ganglionnaire consiste à enlever pour analyse un ou plusieurs ganglions au niveau de l’aisselle. La technique du ‘ganglion sentinelle’ permet de repérer le (ou les) premier(s) ganglion(s) susceptibles d’être envahis par des cellules cancéreuses provenant de la tumeur dans le sein. Si ce ganglion sentinelle est indemne d’envahissement, il n’est alors pas nécessaire d’enlever d’autres ganglions situés en profondeur.
La présence ou non de cellules cancéreuses dans les ganglions va guider le choix des traitements ultérieurs.
La radiothérapie est souvent utilisée pour diminuer les risques de récidive locale après une chirurgie. Elle permet aussi de traiter directement la tumeur lorsqu’une opération n’est pas possible ou d’irradier les zones ganglionnaires autour du sein.
La chimiothérapie est administrée avant ou, le plus souvent, après la chirurgie.
Quand elle est administrée après la chirurgie (chimiothérapie adjuvante), la chimiothérapie est destinée à détruire les cellules cancéreuses présentes dans d’éventuelles micro-métastases indécelables, ou dans des métastases avérées, et qui ne sont pas concernées par les traitements locaux.
Une chimiothérapie peut être administrée avant la chirurgie (chimiothérapie néoadjuvante) afin de réduire la taille de la tumeur et permettre ensuite une opération moins invasive
L’hormonothérapie est souvent combinée à la chirurgie, à la radiothérapie ou à la chimiothérapie. Elle a pour but de réduire le risque de métastases et de récidive.
Ce traitement peut être proposé qu’en cas de cancer du sein “hormonosensible”. Une sensibilité aux hormones signifie que les cellules cancéreuses présentent à leur surface des récepteurs hormonaux. On peut comparer ces récepteurs à des “serrures” dont la clé est une hormone. Lorsque la clé (l’hormone) ouvre la serrure (le récepteur), la multiplication de la cellule cancéreuse est stimulée.
L’hormonothérapie agit de plusieurs façons différentes en fonction du type de traitement (médicaments, chirurgie ou radiothérapie).
Soit des médicaments bloquent l’action des hormones au niveau des récepteurs ou perturbent la production ou la transformation des hormones dans l’organisme. Soit on enlève chirurgicalement les organes qui produisent les hormones (ovaires), ou encore on détruit ces organes par irradiation externe (radiothérapie).
Les thérapies ciblées ne s’attaquent qu’aux cellules cancéreuses qui présentent une “cible” spécifique à leur surface. Dans le cancer du sein, cette cible est le plus souvent le récepteur HER2. Environ un cancer du sein sur cinq est “HER2 positif”.
Des médicaments ciblés ont été spécialement conçus pour traiter ces cancers du sein HER2 positifs.
D’autres traitements ciblés sont envisageables (par exemple en cas de mutation des gènes BRCA1 ou BRCA2) et les recherches se poursuivent activement dans ce domaine.
L’immunothérapie utilise les défenses naturelles du corps pour lutter contre le cancer. Elle améliore la capacité du système immunitaire à attaquer les cellules cancéreuses.
Une immunothérapie particulière (un inhibiteur de checkpoint immunitaire) peut être administrée à certaines patientes qui souffrent d’un cancer du sein triple négatif à un stade précoce. Ce traitement est combiné avec une chimiothérapie avant la chirurgie. Il peut être administré seul après la chirurgie.
N’hésitez jamais à interroger l’équipe soignante (médecins, infirmières et autres soignants) et à répéter vos questions si nécessaire, jusqu’à obtenir une réponse compréhensible. Construisez un véritable dialogue avec vos soignants. Cela vous permettra de prendre, de commun accord et en toute confiance, les meilleures décisions possibles.

Des professionnels pour répondre à toutes vos questions sur le cancer