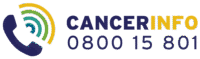Menu

Informez-vous sur les traitements disponibles du lymphome non hodgkinien et prenez des décisions éclairées concernant votre santé.
La chimiothérapie utilise des médicaments qui tuent les cellules cancéreuses. Elle associe habituellement plusieurs médicaments différents qui sont administrés au cours d’un certain nombre de “cycles” espacés dans le temps.
Il s’agit de différents traitements qui utilisent le système immunitaire du patient pour éliminer les cellules cancéreuses. L’immunothérapie vient généralement compléter l’action d’autres traitements.
Généralement, le traitement du LNH comprend plusieurs médicaments associés. Un des traitements de référence combine une chimiothérapie classique (de plusieurs médicaments) à un anticorps monoclonal. Ce traitement est parfois appelé immunochimiothérapie.
Les thérapies ciblées font partie de ce qu’on appelle la “médecine de précision”.
Ces médicaments s’attaquent aux cellules cancéreuses en perturbant sélectivement certaines étapes-clés de leur fonctionnement, ou aux cellules saines qui aident les cellules cancéreuses à se développer. Ces traitements ne sont pas efficaces pour tous les lymphomes. Ils fonctionnent uniquement si des cibles spécifiques (anomalies au niveau de certains gènes ou de certaines protéines) sont présentes au niveau des cellules cancéreuses. Avant de proposer ces traitements, le médecin doit donc déterminer si le LNH du patient pourra être ciblée par un médicament particulier.
Dans certains cas, il peut être nécessaire de compléter les traitements médicamenteux avec une radiothérapie externe. Celle-ci est le plus souvent administrée aux personnes dont le LNH est localisé ou aux patients présentant des ganglions lymphatiques particulièrement volumineux. Elle peut également être administrée pour soulager la douleur lorsque la maladie est avancée.
N’hésitez jamais à interroger l’équipe soignante (médecins, infirmières et autres soignants) et à répéter vos questions si nécessaire, jusqu’à obtenir une réponse compréhensible. Construisez un véritable dialogue avec vos soignants. Cela vous permettra de prendre, de commun accord et en toute confiance, les meilleures décisions possibles.

Des professionnels pour répondre à toutes vos questions sur le cancer