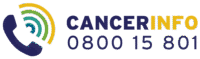Menu

Un cancer du col de l’utérus est composé d’une masse (tumeur) de cellules anormales qui se multiplient de façon anarchique.
La tumeur peut s’étendre en surface dans la muqueuse, ou en profondeur. En continuant sa progression, ce cancer peut envahir de proche en proche les organes voisins comme le vagin, le corps de l’utérus, la vessie, le rectum.
Des cellules cancéreuses peuvent s’échapper de la tumeur d’origine par les vaisseaux lymphatiques et envahir les ganglions, ou par les vaisseaux sanguins et coloniser d’autres organes à distance (foie, poumons, os) pour y former des métastases. Ces métastases sont constituées de cellules cancéreuses venant du col de l’utérus. Elles doivent donc être traitées comme un cancer du col de l’utérus.
En savoir plus :
Les facteurs de risque du cancer du col de l’utérus sont connus depuis longtemps.
Dans plus de 90% des cas, le cancer du col de l’utérus se développe à partir d’une lésion bénigne causée par les virus HPV (Virus du Papillome Humain ou papillomavirus). Il s’agit d’une famille très répandue de virus sexuellement transmissibles.
Il existe des mesures très efficaces pour diminuer fortement le risque de cancer du col de l’utérus.
La vaccination empêche les papillomavirus (HPV) les plus fréquents de s’installer dans le col de l’utérus et donc de provoquer des lésions pouvant évoluer en cancer. Il s’agit de la mesure de prévention la plus efficace à l’heure actuelle puisqu’elle diminue de plus de 70% le risque de cancer ultérieur du col de l’utérus.
Les études scientifiques recommandent la vaccination des jeunes filles avant leurs premières relations sexuelles. (La vaccination des garçons permet de diminuer le risque de transmission ainsi que le développement d’autres types de cancers chez le garçon lui-même plus tard.)
Actuellement, cette vaccination ne protège pas contre les souches moins fréquentes de HPV (qui seraient responsables de 20 à 30 % des cancers du col). Il est donc important de continuer le dépistage par frottis, même chez les femmes vaccinées. Ce dépistage permet de découvrir des lésions précancéreuses et d’intervenir avant le développement du cancer du col.
Vaccination préventive et dépistage sont donc les meilleures manières d’éviter ce cancer.
En Belgique, la vaccination contre les papillomavirus (HPV) est proposée dans le cadre de la médecine scolaire. Les filles et les garçons âgés entre 12 et 15 ans peuvent en bénéficier gratuitement avec l’accord de leurs parents.
Puisque ces virus sont sexuellement transmissibles et augmentent également le risque de certains cancers chez les hommes, la vaccination est également proposée gratuitement aux jeunes garçons.
Une vaccination de rattrapage à 18 ans est remboursée chez les filles et les garçons.
Pour en savoir plus sur le vaccin HPV consultez le site internet de l’organisation responsable en fonction de votre lieu de résidence,:
Une lésion précancéreuse ou un cancer du col débutant passent habituellement inaperçus, d’où l’importance du dépistage. Les symptômes du cancer du col de l’utérus se manifestent généralement à un stade plus avancé de la maladie, parfois même lorsque le cancer s’est déjà propagé aux tissus et organes voisins.
Il peut s’agir de :
A noter que ces symptômes ne sont pas spécifiques au cancer du col de l’utérus. Ils peuvent être le signe d’autres problèmes de santé souvent bénins. Si vous constatez un ou plusieurs de ces symptômes, consultez votre médecin ou gynécologue.
Le dépistage permet de découvrir une lésion précancéreuse ou un éventuel cancer débutant, bien avant l’apparition des premiers symptômes. Plus on détecte un cancer du col de l’utérus tôt, meilleures sont les chances de réussite du traitement.
En Flandre, il existe un dépistage du cancer du col de l’utérus (frottis) gratuit organisé par les autorités. Il est proposé tous les 3 ans aux femmes âgées de 25 à 65 ans qui ne présentent pas de risque particulier.
A Bruxelles et en Wallonie, un dépistage organisé est en cours de préparation. En attendant sa mise en place, les femmes entre 25 et 65 ans bénéficient d’un remboursement complet d’un frottis tous les 3 ans effectué sur base volontaire.
En savoir plus sur :
Une équipe médicale pluridisciplinaire spécialisée établit au cas par cas la meilleure stratégie de traitement possible. Le choix des traitements dépend du type de cancer, de son degré de développement (stade), mais aussi de l’état de santé global de chaque personne.
Les traitements principaux sont :
A tous les stades du traitement, la qualité de vie de la personne malade fait partie des priorités.
Dans tous les cas, l’équipe médicale met tout son savoir-faire pour préserver le mieux possible la qualité de vie, que ce soit à court, moyen ou long terme.
Le but d’un traitement est d’agir contre les cellules cancéreuses. Malheureusement, il peut aussi endommager des cellules saines et causer des effets secondaires. Ces effets secondaires sont très variables en fonction des traitements et d’une personne à l’autre.
Dans tous les cas, nous vous recommandons d’interroger votre médecin afin de savoir à quels effets secondaires vous devez vous attendre et à quoi vous devez faire attention.
En fonction du type de chirurgie, les effets secondaires varient :
L’HYSTÉRECTOMIE TOTALE
Lorsque l’utérus et le col de l’utérus ont été retirés, il n’est plus possible d’être enceinte et il n’y a plus de saignements menstruels (règles). Si la femme n’est pas ménopausée et que les ovaires n’ont pas été retirés, leur fonction hormonale continuera jusqu’à la ménopause naturelle.
En savoir plus sur les effets secondaires possibles de :
Le « Coordinateur de Soins en Oncologie » est un infirmier ou une infirmière spécialisée qui sera votre personne de contact privilégiée tout au long des traitements. Il ou elle fait partie intégrante de votre équipe soignante, assiste à toutes les réunions vous concernant et coordonne tous vos rendez-vous. Votre CSO est facilement joignable, par téléphone ou par mail, pour répondre à vos questions.
Le suivi après les traitements est très important. Votre équipe soignante vous proposera un planning individuel : consultations et examens complémentaires (prises de sang, imagerie, etc.) à un certain rythme, qui s’espacera progressivement au fil du temps. Si de nouveaux troubles ou symptômes font leur apparition entre deux contrôles, il est important d’en informer rapidement votre médecin.
Une rémission signifie une diminution ou une disparition complète des signes de présence du cancer. Lorsque tous les signes ont disparu, on parle de rémission complète. Cela ne signifie pas toujours que la maladie a été totalement et définitivement éliminée. En effet, quelques cellules cancéreuses pourraient avoir survécu. Elles sont trop petites pour être détectées, mais peuvent être le point de départ d’une future récidive. Seul le temps permettra de s’assurer que ce n’est pas le cas. Et c’est à ce moment, avec un recul suffisant, qu’on parlera de guérison.
Tout dépend du type de cancer. Arbitrairement, la barre a été fixée à 5 ans. Mais pour certains cancers, il n’est pas nécessaire de patienter aussi longtemps pour parler de guérison. A l’inverse, certaines récidives peuvent (rarement) se manifester plus de 5 ans après la fin des traitements. En règle générale, plus une rémission se prolonge, plus il y a de chances d’être définitivement guéri.
Le cancer du col de l’utérus est le 23ème cancer le plus fréquent en Belgique.
En 2021, 164 personnes sont décédées de ce cancer en Belgique.
Les chiffres présentés sont des moyennes. Le pronostic individuel dépend notamment du stade du cancer.

Des professionnels pour répondre à toutes vos questions sur le cancer